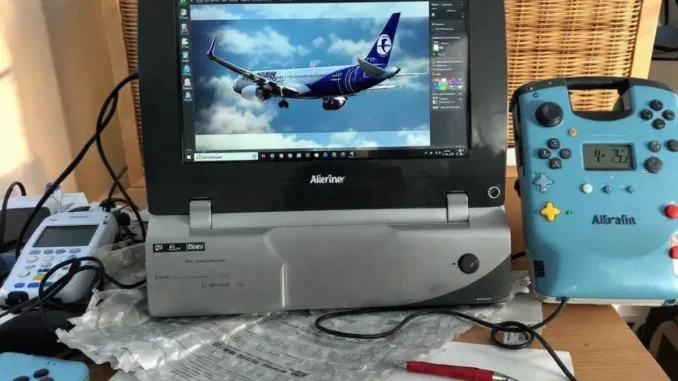
Face à l’urgence climatique, le secteur aérien se trouve au cœur d’une transformation majeure concernant sa responsabilité environnementale. Représentant environ 2 à 3% des émissions mondiales de CO2, l’aviation commerciale fait l’objet d’une attention croissante des législateurs, des tribunaux et de la société civile. Les cadres juridiques évoluent rapidement, imposant de nouvelles contraintes aux transporteurs aériens tout en ouvrant la voie à des mécanismes innovants de régulation. Cette mutation du droit aérien environnemental soulève des questions fondamentales sur l’équilibre entre développement économique et protection du climat, ainsi que sur la répartition des responsabilités entre acteurs privés et publics dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Cadre juridique international de la responsabilité carbone aérienne
Le droit international constitue la première strate normative encadrant la responsabilité climatique des compagnies aériennes. L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) joue un rôle pivot dans ce dispositif. Créée par la Convention de Chicago de 1944, cette institution spécialisée des Nations Unies a progressivement intégré les préoccupations environnementales dans son mandat. La résolution A40-19 adoptée lors de sa 40ème assemblée en 2019 représente une avancée significative en établissant le Régime de Compensation et de Réduction de Carbone pour l’Aviation Internationale (CORSIA).
CORSIA constitue le premier mécanisme mondial de marché visant à stabiliser les émissions nettes du transport aérien international au niveau de 2020. Ce dispositif oblige les compagnies aériennes à compenser leurs émissions excédentaires par l’achat de crédits carbone certifiés. Toutefois, sa mise en œuvre progressive suscite des critiques quant à son ambition limitée. La phase pilote (2021-2023) et la première phase (2024-2026) reposent sur une participation volontaire des États, tandis que la phase obligatoire ne débutera qu’en 2027.
En parallèle, l’Accord de Paris de 2015 influence indirectement la régulation du secteur aérien. Bien que l’aviation internationale ne soit pas explicitement mentionnée dans ce traité, les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) soumises par les États parties peuvent inclure des mesures visant à réduire l’impact climatique du transport aérien domestique. Cette architecture crée une mosaïque réglementaire complexe où les vols intérieurs relèvent des engagements nationaux tandis que les vols internationaux sont principalement régis par le régime CORSIA.
D’autres instruments internationaux complètent ce cadre. Les Standards et Pratiques Recommandées (SARP) de l’OACI définissent des normes techniques concernant l’efficacité énergétique des aéronefs. L’Annexe 16 de la Convention de Chicago, volume IV, établit depuis 2017 une norme de certification CO2 applicable aux nouveaux modèles d’avions. Ces dispositifs techniques constituent le socle d’une harmonisation mondiale des exigences environnementales imposées aux constructeurs et, indirectement, aux compagnies aériennes qui exploitent leurs appareils.
- CORSIA : mécanisme de compensation carbone pour les vols internationaux
- Accord de Paris : cadre indirect influençant les politiques nationales
- Standards OACI : normes techniques d’efficacité énergétique
La fragmentation normative qui caractérise ce régime juridique international soulève d’importants défis d’application. La coexistence de CORSIA avec des mécanismes régionaux comme le Système d’Échange de Quotas d’Émission européen génère des risques de double comptabilité et de distorsion concurrentielle que les tribunaux internationaux pourraient être amenés à arbitrer dans les années à venir.
Régimes régionaux et nationaux : l’Europe en pointe
L’Union Européenne s’est positionnée comme pionnière dans la régulation des émissions aériennes, développant un cadre juridique particulièrement contraignant. Depuis 2012, les compagnies aériennes opérant des vols au sein de l’Espace Économique Européen sont soumises au Système d’Échange de Quotas d’Émission (SEQE-UE). Ce dispositif, fondé sur le principe du « cap and trade », impose aux transporteurs aériens de restituer chaque année des quotas correspondant à leurs émissions de CO2. La directive 2003/87/CE modifiée établit ce mécanisme qui contraint les compagnies à acquérir une part croissante de leurs quotas aux enchères, générant une incitation économique à la décarbonation.
La tentative initiale d’inclure tous les vols au départ ou à destination de l’UE dans le SEQE a provoqué une crise diplomatique majeure en 2012, illustrée par l’affaire Air Transport Association of America et autres c. Secretary of State for Energy and Climate Change (C-366/10). Face aux protestations internationales, l’Union a temporairement limité le champ d’application du système aux vols intra-européens dans l’attente d’un accord mondial sous l’égide de l’OACI. Cette retraite stratégique souligne les tensions juridiques entre ambitions environnementales régionales et principes de souveraineté en droit aérien international.
Le Pacte Vert européen a renforcé cette approche avec l’initiative « ReFuelEU Aviation« . Le règlement 2023/1650 adopté en septembre 2023 impose aux fournisseurs de carburants d’incorporer des proportions croissantes de carburants d’aviation durables (SAF) dans leurs livraisons aux aéroports européens : 2% en 2025, 6% en 2030, jusqu’à atteindre 70% en 2050. Cette obligation indirecte contraint les compagnies aériennes à adapter leurs opérations et leur modèle économique pour intégrer ces carburants plus coûteux.
Mécanismes fiscaux et réglementaires nationaux
Au niveau national, plusieurs États membres ont mis en place des instruments complémentaires. La France a introduit en 2020 une éco-contribution sur les billets d’avion, codifiée à l’article 302 bis K du Code général des impôts. Cette taxe progressive selon la distance parcourue et la classe de voyage varie de 1,50€ à 18€ par passager. La Suède a adopté dès 2018 une taxe carbone aérienne similaire, tandis que les Pays-Bas et l’Allemagne ont suivi avec leurs propres dispositifs fiscaux en 2021.
Ces initiatives nationales soulèvent d’importantes questions de compatibilité juridique avec le droit international de l’aviation. La Convention de Chicago et de nombreux accords bilatéraux de services aériens limitent la capacité des États à taxer le carburant des vols internationaux. Le Tribunal de l’Union européenne a été saisi en 2022 par plusieurs compagnies aériennes contestant la légalité de ces taxes nationales au regard du droit européen et international, notamment sur le fondement d’une possible entrave à la libre prestation de services.
L’articulation entre ces différents niveaux normatifs crée un paysage juridique complexe pour les transporteurs aériens. La multiplication des obligations déclaratives et des mécanismes compensatoires génère des coûts de conformité significatifs, particulièrement pour les opérateurs de taille moyenne. Cette complexité est renforcée par l’émergence de nouvelles obligations de transparence climatique imposées par des réglementations comme le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité (CSRD) qui exige des grandes entreprises européennes, dont les compagnies aériennes, qu’elles publient des informations détaillées sur leur impact environnemental.
- SEQE-UE : système de quotas d’émission applicable aux vols intra-européens
- ReFuelEU Aviation : obligations d’incorporation de carburants durables
- Taxes nationales : éco-contributions sur les billets d’avion
Cette stratification normative pose la question de l’efficacité environnementale et de la sécurité juridique pour les acteurs du secteur, confrontés à des obligations parfois redondantes ou contradictoires selon les juridictions où ils opèrent.
Responsabilité civile et contentieux climatiques émergents
Une tendance jurisprudentielle récente marque l’émergence d’une nouvelle forme de responsabilité des transporteurs aériens : les contentieux climatiques. Ces procédures, initiées par des organisations non gouvernementales ou des collectifs citoyens, visent à faire reconnaître par les tribunaux l’obligation pour les compagnies aériennes de réduire substantiellement leur empreinte carbone, au-delà des exigences réglementaires existantes.
L’affaire Greenpeace c. KLM, introduite devant le tribunal d’Amsterdam en 2022, illustre cette nouvelle approche contentieuse. Les demandeurs y allèguent que les communications publicitaires de la compagnie néerlandaise sur ses engagements environnementaux constituent une forme de greenwashing contraire à la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE). En mai 2023, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de Greenpeace, ordonnant à KLM de cesser certaines communications jugées trompeuses sur sa neutralité carbone future. Cette décision, bien que limitée aux aspects publicitaires, ouvre la voie à des actions plus ambitieuses visant directement les opérations des transporteurs.
En France, le recours en carence contre l’État concernant la régulation du secteur aérien, initié par les associations Notre Affaire à Tous et Oxfam France, pourrait indirectement impacter la responsabilité des compagnies aériennes. Dans sa décision Grande-Synthe du 1er juillet 2021, le Conseil d’État français a reconnu l’obligation pour l’État de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre ses objectifs climatiques. Cette jurisprudence pourrait conduire à un renforcement des contraintes réglementaires pesant sur le transport aérien national.
L’extension du devoir de vigilance aux enjeux climatiques constitue un autre vecteur d’engagement de la responsabilité civile des transporteurs. La loi française n° 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères impose aux grandes entreprises d’identifier et de prévenir les atteintes graves à l’environnement résultant de leurs activités. L’affaire Notre Affaire à Tous c. Total a confirmé en 2022 que les émissions de gaz à effet de serre entraient dans le champ d’application de cette loi. Par analogie, les grandes compagnies aériennes françaises pourraient voir leur responsabilité engagée pour insuffisance de leurs plans de vigilance climatique.
Responsabilité environnementale et principe pollueur-payeur
Le principe pollueur-payeur, consacré à l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, trouve une application croissante dans le secteur aérien. La directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale établit un cadre permettant d’imputer aux opérateurs économiques la réparation des dommages environnementaux qu’ils causent. Bien que cette directive se concentre principalement sur les dommages localisés aux habitats et aux ressources naturelles, certains juristes plaident pour son extension aux dommages climatiques.
Cette évolution potentielle soulève la question complexe de la causalité adéquate entre les émissions spécifiques d’une compagnie aérienne et les impacts du changement climatique. L’affaire néerlandaise Urgenda c. Pays-Bas a établi en 2019 un précédent important en reconnaissant la responsabilité de l’État dans la lutte contre le changement climatique, malgré la contribution relativement modeste des Pays-Bas aux émissions mondiales. Ce raisonnement pourrait inspirer des actions similaires contre des acteurs privés majeurs comme les transporteurs aériens internationaux.
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) constitue également un fondement émergent d’obligations climatiques pour les compagnies aériennes. Les engagements volontaires pris dans le cadre de stratégies RSE peuvent se transformer en obligations juridiquement contraignantes lorsqu’ils sont intégrés aux documents sociaux ou aux communications réglementées de l’entreprise. L’arrêt de la Cour de cassation française du 26 septembre 2018 (n°16-26.503) a confirmé que le non-respect d’engagements éthiques publics pouvait constituer une pratique commerciale trompeuse.
- Contentieux climatiques directs : actions contre les compagnies pour réduction d’émissions
- Actions contre le greenwashing : contestation des communications environnementales
- Extension du devoir de vigilance : obligation d’identifier et prévenir les risques climatiques
Cette judiciarisation croissante de la responsabilité climatique des transporteurs aériens s’inscrit dans un mouvement global de juridicisation des enjeux environnementaux. Les compagnies doivent désormais intégrer ce risque contentieux dans leur stratégie juridique et environnementale, au-delà de la simple conformité réglementaire.
Mécanismes volontaires et stratégies de décarbonation
Face aux risques juridiques croissants, de nombreuses compagnies aériennes développent des initiatives volontaires de réduction de leur empreinte carbone. Ces démarches proactives visent à anticiper l’évolution réglementaire tout en répondant aux attentes des investisseurs et des consommateurs. L’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) a adopté en 2021 une résolution engageant ses membres à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, créant ainsi un standard sectoriel qui, bien que non contraignant juridiquement, exerce une pression normative significative.
Les programmes de compensation carbone volontaire proposés aux passagers constituent l’une des réponses les plus visibles. Des compagnies comme Air France, Lufthansa ou British Airways permettent à leurs clients de calculer et compenser les émissions liées à leurs vols moyennant un supplément tarifaire. Ces mécanismes soulèvent toutefois des questions juridiques concernant la qualité et la vérifiabilité des crédits carbone utilisés. Le règlement européen 2022/2975 sur la certification des absorptions de carbone, adopté en décembre 2022, vise à établir un cadre de certification harmonisé qui pourrait renforcer la crédibilité juridique de ces programmes.
L’investissement dans les carburants d’aviation durables (SAF) représente un autre axe stratégique majeur. Des accords d’achat à long terme (offtake agreements) sont conclus entre transporteurs aériens et producteurs de biocarburants, créant des relations contractuelles complexes qui anticipent les futures obligations réglementaires. United Airlines a ainsi signé en 2021 un contrat d’approvisionnement de 1,5 milliard de gallons de SAF sur 20 ans avec Alder Fuels. Ces contrats comportent généralement des clauses de force majeure et d’adaptation liées aux évolutions réglementaires, témoignant de l’incertitude juridique qui caractérise encore ce marché émergent.
Reporting extra-financier et transparence climatique
Le reporting climatique des compagnies aériennes s’est considérablement renforcé sous l’effet combiné d’obligations réglementaires et d’attentes des marchés financiers. Le règlement européen 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) exerce une pression indirecte sur les transporteurs aériens, les investisseurs institutionnels devant désormais évaluer l’impact climatique de leurs portefeuilles.
La Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) a établi des lignes directrices pour la communication des risques climatiques qui sont progressivement intégrées aux obligations de reporting des sociétés cotées. Les compagnies aériennes doivent notamment publier des analyses de scénarios évaluant la résilience de leur modèle économique face à différentes trajectoires de transition énergétique et de réchauffement global.
Cette transparence accrue génère des risques juridiques nouveaux liés à la qualité et à l’exactitude des informations publiées. L’affaire ClientEarth c. Shell, introduite au Royaume-Uni en 2023, illustre comment des actionnaires peuvent invoquer un manquement aux devoirs fiduciaires des administrateurs lorsque la stratégie climatique d’une entreprise est jugée inadéquate. Ce type de contentieux pourrait se développer dans le secteur aérien, particulièrement exposé aux risques de transition énergétique.
- Engagements sectoriels : objectif de neutralité carbone 2050 de l’IATA
- Compensation volontaire : programmes proposés aux passagers
- Contrats d’approvisionnement en SAF : sécurisation des carburants durables
Ces initiatives volontaires soulèvent la question de leur opposabilité juridique. Des engagements publics de réduction d’émissions, initialement conçus comme des démarches volontaires de RSE, peuvent acquérir une force contraignante lorsqu’ils sont intégrés à la communication financière ou aux documents statutaires d’une compagnie aérienne. Cette transformation progressive de soft law en hard law caractérise l’évolution contemporaine du droit de la responsabilité environnementale.
Perspectives d’évolution et défis juridiques futurs
L’horizon juridique de la responsabilité carbone des compagnies aériennes se dessine autour de plusieurs tendances majeures qui transformeront profondément le cadre réglementaire du secteur. La première évolution attendue concerne le renforcement progressif du dispositif CORSIA de l’OACI. La phase obligatoire débutant en 2027 devrait s’accompagner d’une révision des objectifs d’atténuation, actuellement limités à la stabilisation des émissions au niveau de 2020. Les discussions au sein du Comité de la protection de l’environnement en aviation (CAEP) laissent entrevoir un durcissement des exigences avec l’introduction possible d’objectifs de réduction absolue des émissions à l’horizon 2035.
Dans l’Union Européenne, la révision du SEQE-Aviation prévue en 2026 constitue une échéance critique. La Commission européenne a déjà annoncé son intention de réduire progressivement l’allocation gratuite de quotas d’émission jusqu’à leur suppression complète d’ici 2030. Cette évolution augmentera significativement le coût carbone pour les transporteurs, créant une incitation économique puissante à la décarbonation. En parallèle, l’extension probable du champ d’application du système aux vols extra-européens, temporairement suspendue depuis 2012, reviendra sur l’agenda politique avec la montée en puissance insuffisante de CORSIA.
Le développement des mécanismes d’ajustement carbone aux frontières pourrait également impacter le secteur aérien. Bien que le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) européen adopté en 2023 n’inclue pas initialement les services de transport, son extension future aux importations à forte intensité carbone pourrait indirectement affecter les compagnies aériennes à travers leur chaîne d’approvisionnement. Des discussions sont déjà en cours au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce sur la compatibilité de tels mécanismes avec les règles du commerce international.
Harmonisation des normes et résolution des conflits de juridiction
La multiplication des régimes réglementaires nationaux et régionaux soulève d’importants défis d’harmonisation juridique. Les conflits de juridiction entre mécanismes concurrents de tarification du carbone génèrent une insécurité juridique préjudiciable aux transporteurs opérant sur plusieurs continents. L’articulation entre CORSIA et les systèmes régionaux comme le SEQE-UE reste particulièrement problématique, malgré les efforts de coordination menés par l’OACI.
La Cour de Justice de l’Union Européenne pourrait être amenée à se prononcer sur ces questions de compatibilité, comme elle l’a fait dans l’affaire C-366/10 concernant l’extension initiale du SEQE aux vols internationaux. La jurisprudence qui en découlerait clarifierait les limites de la compétence réglementaire européenne face au principe de souveraineté aérienne consacré par la Convention de Chicago.
Au niveau international, le recours à l’arbitrage prévu par les accords bilatéraux de services aériens pourrait se développer pour résoudre les différends liés aux mesures environnementales unilatérales. Ces procédures arbitrales, traditionnellement focalisées sur les questions d’accès au marché et de capacité, intègrent progressivement les considérations environnementales dans leur champ de compétence.
Innovation juridique et nouveaux modèles de responsabilité
L’innovation juridique accompagnera nécessairement la transition écologique du transport aérien. De nouveaux instruments comme les contrats carbone pour différence (carbon contracts for difference) émergent pour sécuriser les investissements dans les technologies bas-carbone. Ces mécanismes, déjà expérimentés dans le secteur énergétique, garantissent un prix plancher du carbone aux investisseurs, réduisant ainsi le risque financier lié aux fluctuations du marché des quotas d’émission.
Les obligations de transition (transition bonds) constituent un autre outil financier prometteur. Ces titres obligataires, dont le taux d’intérêt est indexé sur l’atteinte d’objectifs de décarbonation, permettent aux compagnies aériennes de financer leur transition écologique tout en créant une incitation contractuelle à la réduction des émissions. Lufthansa a émis en 2021 la première obligation de ce type dans le secteur aérien, levant 1,6 milliard d’euros pour financer le renouvellement de sa flotte.
Enfin, l’émergence d’un droit des générations futures pourrait transformer radicalement l’approche juridique de la responsabilité climatique. Plusieurs juridictions, dont la Cour constitutionnelle allemande dans sa décision historique du 24 mars 2021, ont reconnu l’obligation de préserver les libertés fondamentales des générations futures en limitant les émissions de gaz à effet de serre actuelles. Cette jurisprudence novatrice pourrait fonder de nouvelles actions contre les acteurs majeurs des secteurs à forte intensité carbone, dont l’aviation.
- Renforcement de CORSIA : objectifs plus ambitieux après 2027
- Révision du SEQE-UE : suppression progressive des quotas gratuits
- Nouveaux instruments financiers : obligations de transition et contrats carbone pour différence
Ces évolutions dessinent un avenir juridique où la responsabilité climatique des compagnies aériennes sera de plus en plus intégrée à leur modèle économique et à leur gouvernance. La capacité d’anticipation réglementaire et d’innovation juridique deviendra un avantage compétitif déterminant dans un secteur en profonde mutation.
Vers une nouvelle conception de la mobilité aérienne durable
La transformation juridique de la responsabilité carbone des compagnies aériennes s’inscrit dans une réflexion plus large sur la place du transport aérien dans les sociétés contemporaines. Au-delà des approches purement techniques ou compensatoires, une nouvelle conception de la mobilité aérienne durable émerge, portée par des innovations juridiques et institutionnelles qui redéfinissent les relations entre transporteurs, passagers et autorités publiques.
Le concept de responsabilité partagée gagne du terrain dans les réglementations émergentes. Le règlement européen 2020/852 sur la taxonomie des activités durables introduit une approche systémique qui évalue la contribution des activités économiques aux objectifs environnementaux de l’Union. Pour le secteur aérien, les critères techniques adoptés en avril 2023 reconnaissent la contribution positive des investissements dans les aéronefs à faibles émissions et les infrastructures nécessaires aux carburants alternatifs, créant ainsi un cadre juridique favorisant la réorientation des flux financiers vers la décarbonation du transport aérien.
Cette approche systémique se traduit également par l’intégration croissante du transport aérien dans les politiques de mobilité multimodale. La directive 2021/0207 sur les infrastructures pour carburants alternatifs (AFIR) impose aux aéroports du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) de développer des infrastructures d’alimentation électrique pour les avions stationnaires et des points de ravitaillement en hydrogène. Ces obligations créent un cadre juridique favorable à l’émergence de hubs multimodaux associant aviation durable et modes de transport terrestres bas-carbone.
Les contrats de performance environnementale entre autorités aéroportuaires et compagnies aériennes se développent pour encourager les pratiques opérationnelles vertueuses. L’aéroport de Schiphol a ainsi mis en place un système de modulation des redevances aéroportuaires en fonction des performances environnementales des appareils, créant une incitation économique directe à l’utilisation d’aéronefs moins polluants. Ces mécanismes contractuels complètent les dispositifs réglementaires traditionnels en introduisant une flexibilité adaptée aux spécificités locales.
Droit à la mobilité et justice climatique
La tension entre droit à la mobilité et impératifs climatiques soulève des questions juridiques fondamentales sur l’équilibre entre libertés individuelles et protection de l’environnement. Le débat sur les quotas individuels de carbone pour les voyages aériens, longtemps cantonné aux cercles académiques, commence à influencer certaines propositions législatives. Un rapport parlementaire français de 2022 a ainsi suggéré l’introduction d’un mécanisme limitant le nombre de vols long-courriers par personne et par an, soulevant d’épineuses questions constitutionnelles sur la proportionnalité de telles restrictions aux libertés de circulation.
La jurisprudence européenne sur les droits fondamentaux pourrait jouer un rôle déterminant dans l’arbitrage de ces tensions. Dans l’affaire Greenpeace c. Commission (T-545/11), le Tribunal de l’Union européenne avait déjà reconnu en 2016 que la protection de l’environnement pouvait justifier certaines limitations aux libertés économiques. Cette approche pourrait être étendue pour examiner la compatibilité des futures restrictions au transport aérien avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le principe de justice climatique, progressivement reconnu en droit international de l’environnement, trouve également des applications dans le secteur aérien. La distribution équitable des efforts de décarbonation entre compagnies de pays développés et en développement constitue un enjeu majeur des négociations au sein de l’OACI. Le concept de responsabilités communes mais différenciées, issu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, influence l’architecture de CORSIA avec des exemptions temporaires pour les pays les moins avancés.
Intelligence artificielle et gestion dynamique du trafic aérien
Les technologies numériques ouvrent de nouvelles perspectives pour la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien. Le règlement européen 2021/664 sur l’espace aérien des systèmes d’aéronefs sans équipage établit un cadre juridique pour l’intégration des drones dans l’espace aérien, facilitant le développement de services de livraison aérienne à faible empreinte carbone pour les courtes distances.
L’utilisation de l’intelligence artificielle pour optimiser les trajectoires de vol et réduire la consommation de carburant soulève des questions juridiques complexes en matière de responsabilité et de protection des données. Le projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle proposé en avril 2021 classe les systèmes de gestion du trafic aérien parmi les applications à haut risque, imposant des exigences strictes de transparence algorithmique et de supervision humaine.
Ces innovations technologiques s’accompagnent d’une évolution des modèles contractuels entre compagnies aériennes et prestataires de services de navigation aérienne. Les accords de performance basés sur les résultats (performance-based agreements) lient la rémunération des services de contrôle aérien à l’atteinte d’objectifs environnementaux, créant une incitation économique à l’optimisation des routes aériennes et des procédures d’approche.
- Taxonomie européenne : classification des activités aériennes durables
- Contrats de performance environnementale : modulation des redevances aéroportuaires
- Systèmes de gestion du trafic optimisés par IA : réduction de la consommation de carburant
Cette transformation multidimensionnelle du cadre juridique de l’aviation témoigne d’une évolution profonde de la conception même de la mobilité aérienne. D’un modèle centré sur la croissance quantitative du trafic, le secteur évolue vers une approche qualitative intégrant pleinement les externalités environnementales dans sa gouvernance et son économie. Cette mutation, encore inachevée, redéfinit les contours de la responsabilité sociétale des transporteurs aériens pour les décennies à venir.
